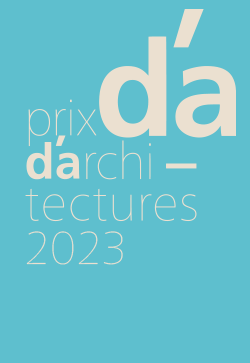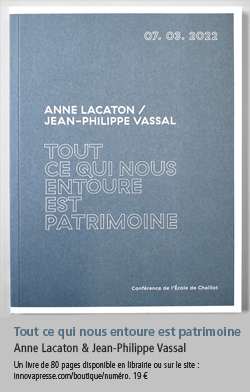Entretien avec Heleen Hart & Mathieu Berteloot, Atelier HBAAT : Dessine moi une maison
Rédigé par Richard SCOFFIERPublié le 05/09/2022
 HBAAT portrait |
Après la visite du cinéma municipal de Marcq-en-Barœul, lauréat du Grand Prix d’architectures 10+1 2021, puis du tiers-lieu de Cappelle-en-Pévèle et de la maison unifamiliale de Lambersart, nous retournons à l’agence, une ancienne salle de bal située dans Wazemmes, un quartier populaire de Lille. C’est un vaste espace de travail et d’expérimentation, un atelier qui, avec sa grande cuisine, reste proche d’un espace domestique. Nous prenons place parmi un amoncellement de maquettes de projets en cours... |
D’A : Qu’est-ce qui vous a poussés à commencer vos études dans une école d’architecture ?
Heleen Hart : Jeune, je me sentais attirée par le monde de l’art en général, la peinture, la musique comme le design, sans savoir quelle place y prendre. Les choses se sont précisées en terminale après la visite de la rétrospective Malevitch à Amsterdam. J’ai saisi dans cette exposition qui montrait les rapports du suprématisme et du constructivisme l’étroite imbrication possible entre l’architecture et l’ensemble des autres arts.
Par ailleurs, j’ai aussi été sensibilisée très jeune à la variété des modes d’habiter. D’origine néerlandaise, je voyageais régulièrement de la France vers les Pays-Bas. Et je ressentais sans me l’expliquer que ce pays offrait une manière de vivre très différente, exprimée notamment par les grandes baies vitrées des maisons hollandaises qui laissaient pénétrer sans retenue le monde extérieur au cœur de leur intimité. Ce que je percevais très bien quand nous allions chez ma tante à Pijnacker : une maison de plain-pied sur la rue conçue autour d’un patio, un bel exemple d’architecture moderne des années 1950. Cette habitation directement connectée à la ville me paraissait sans commune mesure avec le pavillon de banlieue que j’occupais avec ma famille à proximité de Rouen.
Mathieu Berteloot : J’ai toujours aimé le dessin et les travaux manuels. Mon grand-père était menuisier-charpentier, comme mes oncles qui travaillaient au bout de la rue de la maison où j’ai grandi. Un atelier adossé à une vaste cour où les bois, livrés une fois par an, séchaient sous une petite halle contigüe. C’était mon terrain de jeu quand je n’avais pas école. J’y ai passé beaucoup de temps à assembler des chutes de bois avec des clous pendant que mes oncles fabriquaient des fenêtres et des escaliers en bois massifs, ou encore des charpentes qu’ils traçaient préalablement à la mine de plomb sur de grands panneaux de contreplaqué.
Dans ce milieu, rien n’était jeté : les chutes étaient soigneusement triées, entreposées ou, en dernier lieu, utilisées pour le chauffage. Même les clous et les vis qui traînaient par terre étaient ramassés une fois par semaine, le samedi matin. Partout pesait une grande attention à l’économie de matière.
Plus tard, au lycée, j’ai choisi un enseignement en arts appliqués. Ce qui m’a permis de découvrir, avant de rentrer en école d’architecture, le dessin, le design, le graphisme, mais aussi l’histoire de l’art et de l’architecture.
D’A : Comment se sont déroulées vos années d’études ?
Mathieu Berteloot : L’école était très orientée vers les arts plastiques. Les enseignants de cette discipline n’étaient pas forcément des artistes très reconnus, mais ils étaient de grands pédagogues et surtout des passeurs qui invitaient les étudiants à travailler dans les marges et à établir des liens entre l’architecture et l’art contemporain.
Mais ce qui nous a peut-être le plus influencés se produisait hors les murs, avec la construction d’Euralille. Ce chantier, parmi les plus importants d’Europe, était en partie en train de s’achever avec des projets hors normes comme le Congrexpo de Rem Koolhaas, la tour du Crédit Lyonnais de Christian de Portzamparc ou le Triangle des gares de Jean Nouvel... Des projets qui résonnent moins aujourd’hui mais qui ont retenu toute notre attention dans les années 1990-2000. Il ne faut pas oublier que cette opération a placé d’un seul coup Lille au niveau des grandes métropoles internationales : Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam. L’école était aussi animée par un débat permanent autour de la figure de Rem Koolhaas, entre les enseignants et les étudiants qui le critiquaient et ceux qui comme moi et défendait. Un débat qui nous obligeait à nous positionner et à argumenter constamment. Ainsi notre groupe allait souvent à Rotterdam ou à Amsterdam pour visiter les projets de Rem Koolhaas bien sûr, mais aussi de MVRDV, Mecanoo, ou encore Riedijk et Neutelings. En contrepoint, certains enseignants nous faisaient découvrir au même moment le régionalisme critique, avec Alvaro Siza, Souto de Moura...
Heleen Hart : Moi aussi, pendant mes années de formation, j’étais très intéressé par Rem Koolhaas ainsi que par Jean Nouvel... Mais j’ai découvert, lors d’un échange d’une année au Brésil à l’UFF de Niterói, un autre univers : l’architecture de Lina Bo Bardi, alors inconnue en France, ainsi que les jardins de Roberto Burle Marx, d’une richesse incroyable. Dans le cadre d’une étude universitaire, j’ai parcouru le pays à la découverte du mouvement moderne brésilien, les premières œuvres d’Oscar Niemeyer, celles d’Eduardo Reidy, de Gregori Warchavchik ou de Lúcio Costa.
En rentrant en Europe, pour rester dans une certaine continuité culturelle, je me suis installée à Porto où j’ai vécu cinq ans. Là, j’ai pu suivre l’enseignement d’Adalberto Dias à la FAUP, un architecte avec lequel j’ai préparé mon diplôme. Son enseignement m’a appris la rigueur du dessin, la composition, le souci du détail. Puis, j’ai intégré l’agence de Carlos Castanheira, proche d’Alvaro Siza, qui menait les études d’exécution pour la Casa da Música et concevait de nombreuse de structures bois. J’étais très sensible à la manière dont les architectes de cette région parvenaient naturellement à interpréter dans un langage épuré les préoccupations de l’architecture vernaculaire.
D’A : Et vous mathieu, votre diplôme ?
Mathieu Berteloot : Un projet très « koolhaassien » dans un site coincé sous le périphérique à l’entrée de Lille. J’avais repris l’expression de Pierre Mauroy qui voulait faire d’Euralille une turbine tertiaire pour proposer à cet emplacement très contraint mais au contact de la ville et des faubourgs une turbine culturelle. C’était un projet XXL, une plateforme logistique « métropolitaine » pour l’art contemporain – à la fois espace d’expositions, ateliers, studios d’enregistrement et résidences d’artistes – qui anticipait à sa manière le programme de la Fondation Lafayette que Rem Koolhaas a réalisé récemment dans le Marais à Paris.
D’A : Est-ce à l’école d’architecture de lille que vous avez décidé de faire des projets ensemble ?
Heleen Hart : Non, nous avons tous les deux fait nos études à Lille mais avec quelques années d’écart. Nous nous sommes rencontrés plus tard chez Tank, une agence lilloise où nous avons collaboré.
Mathieu Berteloot : Nous avons ensuite créé l’atelier, il y a maintenant dix ans.
D’A : Aviez-vous des projets pour pouvoir vous installer ?
Mathieu Berteloot : Non, mais à cette époque il était plus facile d’accéder à la commande sans forcément avoir de références. Les marchés publics étaient plus nombreux qu’aujourd’hui. Nous avons ainsi après concours pu réhabiliter et réaliser l’extension de la maison commune de Proville, dans le Cambrésis, une commune rurale que nous connaissions pour y avoir construit auparavant une médiathèque pour l’agence Tank.
D’A : Comment les choses se sont-elles passées ensuite ?
Mathieu Berteloot : Après cette première expérience, nous avons obtenu d’autres commandes du même type, comme l’école de danse de Quesnoy-sur-Deûle, un restaurant scolaire pour la ville de Lomme, ou le tiers-lieu de Cappelle-en-Pévèle. Essentiellement de petits équipements en milieux ruraux ou périurbains, dont nous dessinions tous les détails avant d’en suivre attentivement les chantiers.
D’A : Comment vous êtes-vous associés avec Pierre Hebbelinck ?
Mathieu Berteloot : Nous étions très intéressés par son travail. J’ai découvert son œuvre dans le Pavillon belge de la Biennale de Venise de 1996, alors que j’étais encore étudiant. Et habitant à proximité de Mons, nous sommes allés souvent au musée des Arts contemporains du Grand-Hornu, qu’il a réalisé avec Pierre de Wit.
Heleen Hart : Alors que nous venions de monter notre structure, nous leur avons proposé une association pour répondre au concours du musée du Verre de Sars-Poteries. Nous n’avons pas gagné mais les choses s’étant très bien passées, nous avons continué à collaborer. Nous avons ainsi réalisé avec eux la transformation de deux halles Perret à Montataire, puis la rénovation et l’extension de l’ancienne Maison de la culture de Châlon-sur-Saône.
D’A : Vous parliez avec passion de Koolhaas, mais c’est un monde complètement différent...
Mathieu Berteloot : Pas complètement. Si on regarde attentivement l’œuvre construite de Rem Koolhaas entre 1980 et 1990, on observe certains points communs. Je pense notamment à la structure mais aussi à la mise en œuvre. Le Kunsthal de Rotterdam ou le Congrexpo de Lille sont des exemples qui illustrent parfaitement cette question de l’autonomie de la structure et de son indépendante avec l’enveloppe. L’un comme l’autre, ils savent jouer alternativement sur la relégation du second œuvre et sur sa sublimation par des déplacements et des détournements : une manière de considérer les matériaux bruts avec une distanciation absolue qui renvoie aux démarches des artistes de l’Arte Povera. Un procédé visible notamment au Congrexpo, où le béton et l’isolant sont apparents et où la façade principale se présente comme une magnifique ondulation de polycarbonate jaune qui semble avoir été dorée à la feuille d’or.
D’A : Qu’est-ce que Pierre Hebbelinck vous a apporté ?
Heleen Hart : Sa méthode de travail. Il parvient à faire coopérer et à responsabiliser l’ensemble des acteurs de la construction de manière à insuffler pendant les études comme sur les chantiers un véritable esprit d’équipe. Avec lui, les bureaux d’études, les entrepreneurs, les fabricants et les compagnons coproduisent réellement le projet.
L’importance aussi qu’il donne à la maquette, qu’il considère comme un outil essentiel à l’instauration d’un processus collaboratif. Nous nous en servons en permanence dans notre atelier pour dialoguer avec nos collaborateurs comme avec nos maîtres d’ouvrage. Nous l’amenons aussi sur le chantier car c’est un support infaillible pour repérer les problèmes constructifs et discuter des solutions avec les compagnons.
Mathieu Berteloot : C’est un architecte qui a su donner à sa pratique une dimension sociale et politique. À travers ses projets, ses conférences, les débats qu’il organise, les livres qu’il édite dans la maison d’édition qu’il a lui-même créée, il s’engage, il milite, il combat pour que l’architecture retrouve une place prépondérante dans la société et redevienne un bien commun.
D’A : Avez-vous le même type d’engagement ?
Mathieu Berteloot : Nous ne publions pas de livres, mais dans notre pratique d’enseignants et d’architectes nous nous engageons au quotidien. Notamment à travers le choix des programmes sur lesquels nous répondons. Je pense aux projets ruraux ou périurbains, que nous préférons aux ZAC, ainsi qu’aux rénovations, que nous préférons aux démolitions, des solutions de facilité trop souvent retenues aujourd’hui encore.
En matière de logements collectifs, nous privilégions des opérations plus modestes d’habitats participatifs. C’est une façon de considérer les usagers comme des co-constructeurs et comme des acteurs de la société. Nous sommes intimement persuadés que c’est une solution viable pour réconcilier les habitants avec leur logement comme avec leur voisinage.
Heleen Hart : Cette manière de collaborer avec les habitants ou les utilisateurs apporte une dimension humaine supplémentaire à l’architecture. Nous passons beaucoup de temps à dessiner et à réaliser ces programmes ordinaires, très souvent éloignés des métropoles. Nous les saisissons comme des occasions d’expérimenter au gré des contextes et de rencontres. Chaque projet nous permet de monter une équipe spécifique, avec des historiens comme Richard Klein ou Joseph Abram, avec lesquels nous avons travaillé à Montataire, avec des artistes comme Pierre Toby à Saint-Lô, ou des designers comme Anne Masson et Éric Chevalier qui ont réalisé les rideaux du tiers-lieu de Cappelle-en-Pévèle en découpant et en assemblant des tapis de sols, récupérés d’un stock d’invendus d’une usine locale qui avait mis fin à sa production.
D’A : D’où vient cet attrait pour les matériaux bruts ?
Mathieu Berteloot : Nous avons quand même tous les deux fait nos études à l’École d’architecture de Lille, un bâtiment brutaliste réalisé par Pierre Eldin en 1977 qui se présente comme une structure poteaux-poutres en béton avec un remplissage en parpaing. Et puis nous avons été immédiatement confrontés à des projets aux contraintes économiques très fortes.
Heleen Hart : C’est aussi un moyen de répondre à la déqualification de la main-d’œuvre sur les chantiers. C’est une réalité avec laquelle nous devons composer et qui nous amène à utiliser des matériaux faciles à mettre en œuvre.
D’A : Quels sont les principes qui régissent votre démarche ?
Mathieu Berteloot : Nous essayons d’abord de penser le projet par la structure. Nous lui accordons une autonomie importante et c’est elle qui le plus souvent définit les espaces et les usages. L’enveloppe ou la façade viennent systématiquement après. Cette mise en exergue de la structure nous a naturellement entraînés à la réduction du second œuvre et de tout ce qui pourrait venir l’habiller ou la masquer.
Pour nous, il est essentiel de la montrer telle qu’elle est, que ce soient les portiques en bois du tiers-lieu à Cappelle-en-Pévèle, ou les poutres, les poteaux, les planchers hourdis et les murs en parpaing de la maison de Lambersart.
De même, dans les réhabilitations, nous cherchons à faire réapparaître le squelette du bâtiment en retirant toutes les couches apportées au fil du temps. Nous l’avons fait pour la scène nationale de Chalon-sur-Saône où nous avons scié certaines dalles existantes pour rendre visible le jeu des piliers et des poutres en béton, ou à Montataire où nous avons isolé et restauré l’exosquelette des frères Perret pour y glisser la nouvelle façade en parpaing, comme dans la coquille d’un bernard-l’hermite.
Heleen Hart : Mettre la structure en avant nous oblige à travailler à partir d’une trame constructive, ce qui nous permet d’échapper à la composition. Par ailleurs, nous n’avons pas de matériau de prédilection, nous raisonnons aussi bien en termes de poteaux-poutres, bois ou béton, qu’en termes de maçonnerie en brique ou en parpaing... Ainsi la structure en peuplier du restaurant scolaire de Lille : visible de toutes parts, elle définit la silhouette extérieure et assure à l’intérieur la partition spatiale. Elle intègre avec ses sheds en toiture la ventilation naturelle et répond aux normes d’une construction bioclimatique. Ici la question de l’enveloppe ne s’est pratiquement pas posée...
Nos projets répondent à des contextes, des programmes très différents. Bien sûr il y a entre eux des similitudes, des récurrences : elles ne sont pas le fait d’une volonté formelle mais elles découlent de notre approche méthodologie qui dans tous les cas reste la même. C’est d’autant plus sensible que nous construisons très souvent dans des paysages fragiles, en périurbain, ou en milieu rural.
D’A : J’ai l’impression que tous vos bâtiments sont des maisons. Même le cinéma municipal de Marcq-en-Barœul, très fragmenté, peut rappeler la villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens.
Heleen Hart : Oui, c’est vrai. Nous sommes très intéressés par l’échelle domestique, aussi bien dans les maisons particulières et les habitations participatives que dans les équipements. À la fois dans la mise en forme des espaces mais aussi dans les relations que nous essayons d’instaurer avec les équipes durant les études et le chantier comme avec les usagers.
Mathieu Berteloot : Dans les logements participatifs de Lille, dans le quartier des Bois-Blancs, les huit familles habitent effectivement comme dans une grande maison. Dans le projet de Marcq-en-Barœul, la maison est une petite ville qui accueille un cinéma, une salle de spectacle, une brasserie et une annexe de l’école de musique. Que ce soit une habitation individuelle ou un équipement, ce sont toujours des aventures humaines. L’intérêt de notre métier réside essentiellement dans les rencontres qu’il rend possibles.
C’est pour cela que nous nous sommes très investis dans le logement participatif. Il articule l’échelle de la cellule individuelle avec celle d’une organisation collective plus vaste. Derrière chaque logement il y a une famille, une personne âgée seule, un couple de retraité... Ce sont à chaque fois des expériences créatives très intenses et inédites, surtout parce qu’à un moment donné le statut d’auteur se partage. C’est la condition même de cet exercice fondé sur la co-conception.
Les articles récents dans Le Grand Entretien
 |
Entretien avec Philippe Prost, le 29 octobre 2024Fin de matinée, j’ai rendez-vous avec Philippe P… [...] |
 |
Je sors du métro, par un long escalator, place des Fêtes, cette anomalie dans Paris. Des tours uni… [...] |
 |
5, rue Curial, 11 h. Le Centquatre est encore fermé, j’interpelle un vigile à travers la grille … [...] |
 |
Après avoir composé le code de la porte, je quitte la bruyante et cosmopolite rue d’Avron pour b… [...] |
 |
À l’occasion de la diffusion du film Architectes de campagne* réalisé par Karine Dana, la Gal… [...] |
 |
L’immeuble des Tiercelins, la première réalisation de cette agence créée à Nancy dès la fin… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
CLASSEMENT PAR CHIFFRE D’AFFAIRES DES AGENCES D’ARCHITECTURE FRANÇAISES (AU CA SUPÉRIEUR À 1 …
Chaque année, d’a publie un classement des agences d’architecture par chiffre d’affaires. Celui-ci repose uniquement sur des données financiè… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6
L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6
L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |
 |