Radicant, la modernité émergente
Rédigé par . D'ARCHITECTURESPublié le 29/08/2011
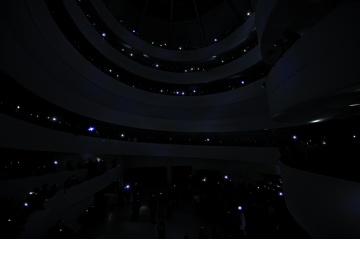 Opening, une pièce de Pierre Huygue mise en scène pour ett par le public lors du vernissage de l'exposition "Theanyspacewhatever" au musée Guggenheim de New-York. K Mackay photographer |
Dossier réalisé par . D'ARCHITECTURES |
DA : Quel sens donnez-vous au terme « radicant », qui donne son titre à votre ouvrage ?
Nicolas Bourriaud : Ce terme est né d'une interrogation sur la période historique que nous sommes en train de vivre, et sur la validité du terme « postmoderne » qui la qualifie le plus souvent. Mon hypothèse première est qu'émerge aujourd'hui ce qui pourrait s'apparenter à une modernité. Pour montrer la pertinence de ce phénomène, que j'ai baptisé « altermodernité », il faut revenir sur les notions constitutives du modernisme du XXe siècle, toujours vivace mais à mon sens déconnecté de notre époque. Parmi elles, la radicalité, qui hante toujours la critique d'aujourd'hui. Radicalité signifie « appartenance à la racine ». J'avais déjà utilisé ce terme de radicant voici presque vingt ans, sans le développer. Y revenant, je me suis rendu compte qu'il désignait un possible modèle opératoire pour des démarches artistiques ou théoriques d'aujourd'hui.
Littéralement, est radicante une plante qui fait pousser ses racines au fur et à mesure qu'elle avance. Transposé dans le domaine de la création contemporaine, ce terme me paraît assez fécond, dans la mesure où il permet de comprendre un certain nombre de démarches. Un malentendu pourrait venir de la confusion avec la figure du « rhizome » proposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari.
En botanique, un rhizome désigne une structure dans laquelle chaque point est connecté à tous les autres. Le rhizome est apparu comme une métaphore du réseau, raison du succès de cette figure dans l'imaginaire de l'Internet, par exemple. Tandis qu'une plante radicante, comme le lierre, trace une ligne qui développe des arborescences. Au figuré, cette idée de ligne est importante : elle renvoie à celle de parcours et peut rendre compte d'une culture dans laquelle la question de l'origine s'efface devant celle de la destination. « Où aller ? » est la question moderne par excellence. Alors que le postmodernisme pose systématiquement celle de l'origine, développant une pensée binaire qu'en même temps il critique en permanence. En opposant les colons et les colonisés, le Nord et le Sud, les dominants et les dominés, ce binarisme est stérile. De même, le multiculturalisme n'a de multiple que son nom : il réfère à une situation dans laquelle un immigrant se trouve confronté à des autochtones. Avec les concepts de radicantité et d'altermodernité que j'avance, il m'intéresse de briser ce type de symétries pour leur préférer le relativisme, à la suite d'un Bruno Latour qui privilégie de son côté le « non symétrique ».
DA : La modernité du XXe siècle frayait avec l'idée de rédemption du monde. Privilégier la question de la destination renvoie-t-il à une nouvelle forme de messianisme ?
NB : La notion de destination me sert plutôt à désigner le parcours d'un individu ou d'un groupe radicant qui négocie, à mesure de son trajet, son ancrage et son degré d'adhésion à un territoire ou une situation. Il ne s'agit pas d'une destination métaphysique, mais de l'invention d'un parcours, et donc de l'invention de soi, individuel ou collectif. Car il s'agit de l'invention d'un sujet ou d'un groupe sujet. Je me réfère à ceux qui ont tenu bon sur cette question du sujet, tel Jacques Lacan dans les années soixante, au sein d'une pensée structuraliste qui le déconstruisait ou lui substituait d'autres modes de subjectivation.
La ligne complexe que décrit un mécanisme radicant constitue un sujet, non par son identité ou ses identités successives, mais bel et bien par le parcours qu'elle trace. Non seulement par ses qualités intrinsèques, mais également par la nature des rapports que ce sujet va entretenir avec les sols qu'il traverse. C'est une théorie du sujet qui décolle de ses identités. L'identité colle, d'une certaine manière : elle nous plaque sur des ensembles. Le modernisme du XXe siècle était « continental » dans la mesure où il avait vocation, parfois messianique, à l'universalisme. L'altermodernité est archipélagique ; elle est constellation d'îles. Il n'y a pas de volonté hégémonique, mais celle de créer, entre des éléments distincts, des rapports organisés. Un archipel réunit des îles dans une figure commune.
DA : Le sujet contemporain possède ainsi des identités multiples et interchangeables ?
NB : Il faudrait réussir à éviter le terme d'identité. Avec lui, on renvoie le sujet à sa culture, terme lui-même ambigu parce qu'il a changé de sens. L'acception anglo-saxonne l'a emporté, finissant par recouvrir celui de civilisation qu'il désignait. L'ouvrage de Freud a d'abord été traduit par Malaise dans la civilisation (le mot allemand était Kultur) ; il est devenu Malaise dans la culture. La culture est devenue un marquage identitaire qui renvoie à des relations d'appartenance : il agit par assignation. La théoricienne indo-américaine Gayatri Spivak parle d'un « essentialisme stratégique » : avec elle, le repli communautaire deviendrait une arme radicale.
C'est bien ce contre quoi il faut précisément lutter. Le repli identitaire, sous couvert de lutte contre l'hégémonisme culturel, produit en effet des effets atrocement pervers. Je préfère le dialogue, non pas multiculturel – qui renverrait au binarisme que je dénonçais –, mais horizontal, permettant la constitution d'hybrides résultant d'un cabotage d'île en île. Les artistes qui m'intéressent, au lieu de travailler à partir de « leur » culture, travaillent par destination : ils visent des figures culturelles, au lieu de partir de celles-ci.
DA : Vous parlez dans votre livre « d'esthétique radicante ». Que recouvre-t-elle ?
NB : Tout d'abord, pourquoi employer ce terme d'esthétique, qui a aujourd'hui bien mauvaise presse ? On demande en effet à l'art d'être éthique, ou politique, alors que sa dimension esthétique est très vite évacuée. Celle-ci me paraît pourtant centrale et éminemment politique. Comment préserver le domaine esthétique dans un contexte qui n'en veut pas, parce qu'il renverrait à un discours normatif ?
L'enjeu central de l'esthétique aujourd'hui est de renouveler le concept de forme. L'esthétique est disqualifiée quand elle est renvoyée au formalisme. Or ce discours, tenu par Clément Greenberg ou par Theodor Adorno, s'est quelque peu épuisé. Il est possible de renouveler l'esthétique en élargissant son objet. C'est pourquoi je préfère parler de « formations », plutôt que de formes. Une formation est encore irrésolue, elle fait émerger quelque chose qui se développe dans le temps et dans l'espace. Une formation n'est pas forcément une forme, elle peut être un collectif ou un groupe formel. L'enjeu central de la pratique d'un Pierre Huygue n'est pas de produire une forme mais une formation qui elle-même rentre en contact avec d'autres formations. Dès lors qu'on établit cette notion, on élargit le champ de l'esthétique sans le quitter.
DA : Vous avancez encore l'idée de précarité esthétique. Elle interpelle l'architecture, qui elle-même se pense dans la pérennité.
NB : La précarité est un thème central de mon livre. La précarité est un thème à la fois social et politique. C'est la modernité « liquide » dont parle Zygmunt Bauman quand il explique que nous vivons dans l'univers du jetable. Il y a aussi une précarité esthétique : la precaria, en droit romain, désignait un privilège révocable à tout moment.
Dans le domaine esthétique, la précarité signifie que toute définition de l'art est révocable, qu'elle est toujours en mouvement, qu'il s'agit d'un processus sans stase, un pur dynamisme. Il n'y a pas d'autorité qui tendrait à fixer, à ériger en normes, à prononcer des arrêts. S'intéresser à l'histoire, du point de vue de Walter Benjamin, c'est faire émerger la voix des vaincus, c'est remettre en question le tribunal de l'histoire et rejouer le procès en permanence, sans s'arrêter sur des certitudes ou des jugements définitifs. L'histoire de l'art ne cesse d'interroger les hiérarchies – ce qui n'implique pas qu'il n'y ait pas de hiérarchie…
DA : Que serait une pratique radicante ?
NB : Comme c'était le cas pour Esthétique relationnelle, j'ai écrit Radicant avec peu de recul sur les pratiques. Mon idée est d'accompagner la naissance d'un phénomène, plutôt que de statuer sur sa conclusion. Rien de conclusif donc, et encore moins de définitif. Esthétique relationnelle, qui date de 1995, mettait en exergue vingt artistes. Radicant cite également des artistes qui illustrent, chacun à sa manière, cette notion. Établir un catalogue ou une typologie des pratiques relèverait d'une approche normative. Ce sont les artistes eux-mêmes qui apportent leur propre réponse à cette question. Mon livre avance des exemples qui permettent de percevoir ce que serait une esthétique radicante. Je me contente de décrire ce qui émerge, et essaie d'échapper à la posture classique de la critique sur l'art qui consiste à plaquer une théorie sur les choses ou une grille sur le réel. Je préfère que la théorie émerge des pratiques.
DA : La question de la réinvention de la démocratie se pose aujourd'hui avec force : il s'agit de trouver de nouveaux rapports d'échange entre les sujets. Elle traverse aussi le travail artistique et ses pratiques : comment l'artiste peut-il échapper à la posture d'autorité qui lui est donnée ?
NB : Une partie de la réponse se trouve dans mon livre Postproduction, publié en 2002, qui interroge les frontières entre le producteur et le consommateur, l'artiste et le regardeur, les figures de la passivité et de l'activité. Le point commun entre mes livres se trouve sans doute dans la critique du schéma origine/fin. Esthétique relationnelle traitait de la participation du regardeur ou de sa prise en compte par un dispositif artistique. Postproduction, des artistes qui utilisent des objets et des formes déjà socialisées – ils ne travaillent pas sur une page blanche, pour se placer à l'origine, mais s'insèrent dans le réel et composent avec lui. Radicant déploie la même critique de l'origine au niveau culturel et interculturel. Ce point central, commun, a bien entendu trait à la démocratie dont l'élément central est le rapport entre pouvoir et sujet. L'art propose des modèles qui interrogent la relation, généralement binaire, entre dominant et dominé, pouvoir et sujet, voire entre les sujets, qui incorporent leur relation au pouvoir.
Louis Althusser proposait une définition de l'idéologie qui reste pertinente. L'idéologie, disait-il, nous interpelle, et en nous interpellant comme un policier qui nous siffle dans la rue, elle nous constitue en sujet idéologique : sitôt que nous nous reconnaissons dans l'interpellation, nous sommes pris par l'idéologie. Quelle est la réponse à donner aux coups de sifflet permanents de l'idéologie aujourd'hui ? Comment faut-il y répondre ? La question du commanditaire est centrale. À qui s'adresse-t-on et comment ? Qui s'adresse à vous ? Quels sont les processus qui constituent une demande ?
DA : Notre idée de la démocratie est toujours rapportée à une origine, une révolution le plus souvent. La réinventer, n'est-ce pas se départir d'un modèle antérieur ?
NB : C'est certainement se déprendre des modèles historiques, non pour les oublier mais pour les dépasser. L'amnésie étant de plus en plus répandue, la mémoire devient un enjeu politique. Dans un monde entièrement quadrillé dont chaque recoin nous est désormais connu, le dernier continent à explorer me semble être celui du temps. Pas seulement celui du passé, mais celui qui bouge sous nos yeux. Nombre d'artistes, avec leurs travaux d'archivistes ou d'archéologues, reposent des questions à l'histoire et au passé, d'une manière hétérochronique. Il ne s'agit pas de revenir à une situation antérieure, ni de faire appel à la citation.
La citation, c'est la chose déjà jugée, alors que l'usage des formes, chez les artistes de Postproduction, permet un rapport à l'histoire envisagée comme une boîte à outils, beaucoup plus féconde dans la mesure où elle échappe à l'autorité du déjà jugé pour se situer dans la sphère des comportements et des pratiques. Cette mise en mouvement de l'histoire est cruciale. Le postmodernisme procède par citations et se place dans le factice, que ses citations soient savantes ou populaires : ce sont toujours des formes d'autorité. D'autres formes savantes peuvent s'y opposer, en agissant comme des contrepoints.
DA : L'idée d'hétérochronie renvoie à la question urbaine, qui ne peut être saisie qu'à condition de rapporter les dimensions spatiales aux dimensions temporelles et qui est elle-même traversée par la même urgence démocratique.
NB : Une « formation », telle que je l'entends et que je la perçois dans les travaux des artistes d'aujourd'hui, s'avère apte à saisir des temporalités et des espaces hétérogènes ; l'œuvre d'art constitue un chaînage de formes qui, d'une certaine manière, reproduit la différence existant entre l'architecture et l'urbanisme. L'art doit être une question publique, non pas dans le sens démagogique d'une « participation » demandée, mais dans la mesure où il met en jeu l'ensemble des processus de visibilité : ce qui est caché, ce qui devient aveuglant, ce qui ne se représente que par le diagramme ou la statistique…
Cette forme « errante » et complexe répond à ce qui constitue pour moi l'enjeu majeur de l'esthétique comme de la politique : la question du multiple. Nous n'avons plus affaire qu'à des images, des processus, des espaces qui s'articulent autour d'une multiplicité d'éléments. Comment on le fait vivre, le multiple, et comment on le représente ? L'hétérochronie, c'est précisément une pensée du temps multiple. Et l'urgence démocratique actuelle passe par cette question : le pouvoir pulvérise et disperse, tandis que l'art tente de rassembler dans une même forme, une même image, tout ce qui a été dispersé et pulvérisé.
Propos recueillis par Emmanuel Caille et Jean-Paul Robert
Nicolas Bourriaud, Radicant, pour une esthétique de la globalisation, éditions Denoël, Paris, 2009, 224 pages, 19 €. Du même auteur : Esthétique relationnelle, Presses du réel, 1998 ; Formes de vie. L'art moderne et l'invention de soi, Denoël, 1999 ; Postproduction, Presses du réel, 2002.
Né en 1965, Nicolas Bourriaud est commissaire d'exposition, écrivain et critique d'art. Il a dirigé le palais de Tokyo à Paris de 2000 à 2006 et est actuellement conservateur à la Tate Britain à Londres.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6
L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6
L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |
 |
















