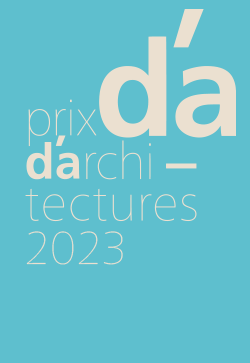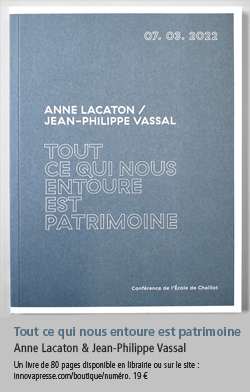L’origine gazeuse de l’architecture
Rédigé par Cyrille SIMONNETPublié le 13/12/2019
 William Turner, Venice with the Salute, 1840-1845, Tate Gallery, Londres. |
Dossier réalisé par Cyrille SIMONNET Comme les
physiciens hésitent entre le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire pour
décrire certains phénomènes (la lumière, l’émissivité des corps noirs), les
architectes situent leur objet dans un entre-deux de plus en plus ambigu :
structure, forme solide d’un côté, espace, lumière, ambiance de l’autre. Dans
un va-et-vient incessant entre le formel et l’informel, l’enveloppe et le
confort, le construit et l’habité, l’objet architecture semble ballotté dans
cette double nature, constitutive, essentielle. Nommons ce rapport pour
simplifier : tectonique versus thermodynamique.
|
Il faut reconsidérer un certain nombre de points, à commencer par celui la place de l’élément (air) dans l’histoire de l’architecture. Reconnaître, déjà, que la considération climatique est beaucoup plus présente qu’on ne le pense dans le corpus de la « théorie » de l’architecture, et même dans le lourd corpus patrimonial bâti, savant ou vernaculaire. À certains égards, et pas seulement par esprit de provocation, on pourrait parler de l’« origine gazeuse de l’architecture », au même titre que Semper parlait de l’« origine textile de l’architecture ». Considérer par exemple la problématique du feu et du foyer comme essentielle à la constitution de l’habitat. Les premières traces de foyer (Terra Amata, il y a 400 000 ans) sont également des traces d’habitat. Tout au long de son évolution, l’homme aménage, adapte son environnement immédiat, invente ou construit des abris pour en contrôler l’atmosphère. Reyner Banham ne s’y était pas trompé en introduisant son précieux essai sur L’Architecture de l’environnement bien tempéré par une « apologie superflue » mettant dans le doute l’homme primitif hésitant à couper ou brûler le bois, pour construire ou se chauffer…
La nature et la position du foyer dans l’architecture traditionnelle, son usage très ritualisé, ont conduit un chercheur comme Renaud Lieberherr à établir une relation subtile entre organisation sociale et organisation spatiale à partir de la notion très ouverte de « feu domestiqué ». Âtre, cheminée, braséro, poêle, fourneau… les sources de chaleur qui occupent la maison sont variées et surtout s’accordent aux activités qu’elle renferme. Que ce soit dans la yourte kazakh, le chalet valaisan ou le tipi sioux dans le nord du Dakota, le feu non seulement chauffe l’air ou un conducteur calorique quelconque, mais il établit un espace propre et contribue à qualifier la sociabilité des habitants. Il produit un « espace aériforme » qui fait la maison à proprement parler. Il existe une relation étroite entre la fonctionnalité de ces feux et l’activité économique et domestique des habitants ; de même la structure construite participe aux effets de température issus des foyers. L’exemple des tipis, pourtant habitats nomades, illustre assez bien ce thème. Le cône biais formé par l’armature décentrée du tipi favorise une ventilation qui assure le tirage du foyer et contribue à l’assouplissement des peaux ou au séchage des toiles qui couvrent la structure, empêchant la condensation et l’enfumement de l’espace. Les femmes ramassent le bois, et l’allumage du feu et son entretien sont fortement ritualisés. Le foyer dans le tipi est central. L’homme le contourne par la droite, la femme par la gauche. Tout un protocole du quotidien s’articule au foyer, que l’on n’éteint jamais.
Les exemples sont innombrables et variés. Quel est le bénéfice premier de l’habitat humain, si ce n’est de tempérer l’abri qu’il constitue ? Certes, en cela il partage la fonction avec d’assez nombreuses espèces animales qui construisent essentiellement pour contrôler leur environnement climatique. Déjà, le corps animal (et humain donc) est bardé de capteurs thermiques qui lui facilitent le contrôle de son espace atmosphérique de proximité. Et ce, paraît-il, jusqu’au toucan, dont le bec démesuré régule certains effets thermiques entre son corps et sa sphère climatique immédiate. Entendons alors l’architecture comme un art du climat autant qu’un art de la construction. Un art des températures et de la ventilation autant qu’un art des ordres et des proportions. Cette caractéristique est particulièrement intéressante, offrant à l’artifice de la construction le fondement pour ainsi dire naturel qui lui faisait défaut au regard de l’assiette purement culturelle (et divine…) des styles et de l’harmonie. C’est peut-être alors en gardant à l’esprit cette fonction proprement gazeuse à l’initial qu’il faut aborder la problématique de l’origine, qui fut tant discutée au XVIIIe et au XIXe siècle.
La structure absente
Dès lors, un dispositif apparemment trivial comme le chauffage gagne à être reconsidéré au-delà de l’artifice technique qu’il représente. Emmanuelle Gallo l’a bien montré. Chez Louis Savot, médecin, proto-hygiéniste à certains égards, auteur de L’Architecture françoise des bastimens particuliers (Paris, 1624), c’est la cheminée qui motive la conception des pièces de l’habitation. S’il partage ce souci du confort au niveau de toute une génération, ses réflexions, ses inventions même sont le signe d’une sensibilité à l’environnement que l’on détectera plus tard seulement, au XVIIIe siècle. En médecine notamment, alors que dans la conception des maladies une certaine inflexion néohippocratique se fait jour, privilégiant l’attention à l’atmosphère du malade, à son environnement (grande époque des miasmes). Précisément, fort de sa connaissance de « la forme de l’air en mouvement », le médecin Hugues Maret (1726-1786) préconise de voûter les chambres des hôpitaux en forme de manchon pour accélérer la ventilation. Soufflot s’en inspirera. Le concours pour la reconstruction de l’Hôtel-Dieu à Paris après son incendie en 1772 représente une étape importante de ce point de vue. La quête d’un air « pur et salubre » est un souci partagé, l’harmonie s’inscrit moins dans la beauté des Ordres que dans des dispositions spatiales capables d’expulser les miasmes.
Le thème de l’aération constituera un leitmotiv, dont s’empareront les architectes puis les urbanistes au XIXe siècle. À l’époque de la révolution industrielle, l’hygiénisme s’érigera comme un des grands moteurs de l’attention portée à l’habitat. Les premiers programmes d’habitat social en sont issus. Lauréat du concours organisé par la Fondation Rothschild en 1905 pour la conception de logements ouvriers à Paris, Augustin Rey, « architecte hygiéniste », organise ses plans architecturaux et urbains en fonction de la circulation de l’air. L’architecture fonctionne comme un ventilateur. À noter que ce dernier, inventé par l’ingénieur suédois Triewald en 1743, s’inspirait des travaux de Stephen Hales (Vegetable Staticks, 1727) qui mettaient en évidence la nocivité de l’air expiré. Invisible, informe, substance vitale, siège de toute une population d’« insectes invisibles », l’air est objet d’une attention toute particulière que l’architecture a charge de filtrer, de faire circuler, de purifier. Avant déjà, lors de la reconstruction du Parlement de Londres (Chambre des communes), Christopher Wren avait le souci de l’endurance des parlementaires. Pratiquant des ouvertures en forme de cônes tronqués aux angles du plafond, ayant soin de chauffer la chambre supérieure, il favorisait l’aspiration de la salle viciée par la combustion des chandelles.
Ventiler, aérer constitue une condition essentielle en réponse à la clôture de l’abri. L’artifice spatial, relayé au XXe siècle par l’artifice technique, y contribue. Les architectes modernes en ont fait leur slogan : l’habitat est aériforme. Le Corbusier le premier, qui veut tout rendre « libre » dans la maison pour mieux la faire respirer et mieux l’éclairer. L’enjeu est plus que simplement sanitaire. Comme les peintres impressionnistes conquièrent le « plein air », les architectes radicaux des années 1960 conquièrent l’espace comme une immense bulle – celle que le philosophe Peter Sloterdijk qualifiera d’« immunitaire ». Aujourd’hui, croit-on, les parois, les murs, les structures de la construction ne sont que des artifices passagers, que réclame encore notre standard civilisationnel. Mais de nouvelles catégories guident les concepteurs : « développement durable », « société liquide », « anthropocène », « résilience », « glocal »… Gro Harlem Brundtland – femme politique norvégienne dont un rapport, baptisé « Notre avenir à tous », a abouti à la convocation du sommet de la Terre à Rio, en 1992 – prend la place de Vitruve. Retour au gazeux : l’objet construit n’est que le prétexte d’un meilleur agencement entre nos bulles individuelles, familiales, communautaires parfois. Comme la planète est contaminée, son air pollué, son climat déréglé, que le flux et la connexion l’ont emporté sur l’établissement humain, le toit, le foyer se dissolvent dans le territoire, l’énergie, les autoroutes, les pipelines, les réseaux sociaux. Air du temps, voilà bien la nouvelle substance de nos demeures contemporaines.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
CLASSEMENT PAR CHIFFRE D’AFFAIRES DES AGENCES D’ARCHITECTURE FRANÇAISES (AU CA SUPÉRIEUR À 1 …
Chaque année, d’a publie un classement des agences d’architecture par chiffre d’affaires. Celui-ci repose uniquement sur des données financiè… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6
L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6
L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |
 |