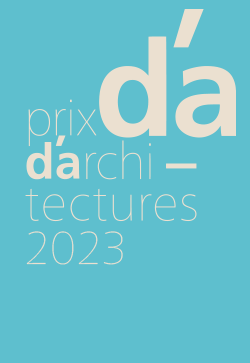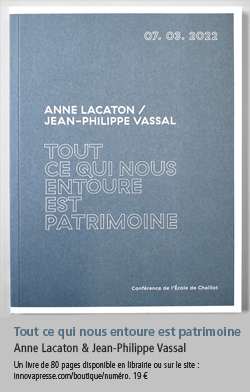Dépasser la rationalité. Les sirènes de l'histoire, entretien entre Roberto Gargiani et Éric Lapierre
Rédigé par Emmanuel CAILLEPublié le 04/01/2021
 Absence of common measure, Superstudio EPFL, septembre-décembre 2020 |
Dossier réalisé par Emmanuel CAILLE Pour
tenter de saisir ce qui rassemble les approches d’architectes que l’on range
parfois sous l’étiquette de « néorationalistes », nous avons fait dialoguer
Roberto Gargiani et Éric Lapierre, qui réfléchissent depuis longtemps à cette
question. Le premier l’a explorée dans son activité d’historien, en publiant
des traités sur l’histoire de la construction, ainsi que des monographies sur
Louis I. Kahn et OMA/ Rem Koolhaas. Plus récemment, Roberto Gargiani a aussi
créé un enseignement de projet baptisé « Superstudio » à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), qui s’accompagne d’un manifeste. L’historien y
prône paradoxalement une architecture qui romprait radicalement avec son passé pour |
s’orienter vers la construction de vastes structures technologiques, les seules qui seraient à même d’accueillir la complexité et l’incertitude qui caractérisent notre monde. De son côté, c’est en tant qu’architecte praticien qu’Éric Lapierre expérimente le rationalisme dans ses projets, dont la résidence étudiante Chris-Marker à Paris, lauréate du Grand Prix d’architecture 2019 ou la plateforme logistique de Toulouse Fondeyre actuellement en chantier. Il s’efforce aussi de le théoriser à travers des expositions comme la Triennale de Lisbonne en 2019, « The Poetics of Reason », à l’occasion de laquelle il a publié Economy of Means, How Architecture Works (Poligrafa, 2020), ou Marvelous Architecture, The Hallucination Of Reason, à paraître en 2021.
Éric Lapierre : Roberto, tu donnes depuis longtemps des cours d’histoire à l’EPFL dont tu as dirigé le département d’architecture de 2011 à 2015. Tes travaux de chercheur ont progressivement glissé vers le contemporain, quand tu t’es intéressé à des figures comme Rem Koolhaas ou OFFICE. Et récemment tu t’es même mis à enseigner le projet en encadrant des diplômes et en dirigeant cette année le « Superstudio » : un dispositif auquel tous les étudiants de l’EPFL doivent se confronter avant leur diplôme. C’est l’une des expériences les plus ambitieuses et radicales qu’il m’ait été donné de voir dans une école d’architecture, qui dépasse le cadre de l’enseignement pour développer un propos théorique. Comment cette expérience pédagogique contribue-t-elle au débat sur la rationalité en architecture ?
Roberto
Gargiani : Quand j’ai organisé l’enseignement du projet pour
Superstudio, en en discutant aussi avec toi en n’ayant jamais dirigé un
atelier, j’ai repensé au fameux arbre généalogique des tendances
architecturales dressé par Charles Jencks, et aux différents avatars de ce dessin,
pour arriver à la conclusion que l’unique héritage de principes puissants pour
le XXIe siècle est le rationalisme. Le rationalisme a été constamment relancé,
que ce soit dans les années 1960 et 1970 en Italie, ou plus récemment dans
l’ensemble de l’Europe, avec aussi ta décisive prise de position à la Triennale
de Lisbonne. Bien au-delà d’être une simple catégorie de l’histoire ou de la
critique, le rationalisme a démontré, à travers les XXe et XXIe siècles, et
grâce à ses principes, sa capacité à devenir une stratégie de projet apte à
répondre aux conditions sociales et politiques, ainsi qu’aux technologies
caractéristiques à une époque donnée. C’est pour souligner cette part
changeante et vitale que je parle, avec les « collectifs » de Superstudio, de «
rationalisme incomplet ». Au fond, même les tendances qui se sont distinguées
du rationalisme se sont construites en réaction par rapport à lui (le
brutalisme a cherché à l’accentuer, tandis que le postmodernisme s’est efforcé
de le critiquer, de le subvertir). Et actuellement, les contraintes liées à la
durabilité et certaines transformations sociales, qui ont pris le statut
théorique de la « multitude », nous conduisent à réactiver le rationalisme pour
son pouvoir d’antagonisme. Dans le rationalisme à venir, le principe
fondamental du plan libre rendu possible par l’apparition de l’ossature ne peut
plus tout à fait être le même que celui des origines. Ce principe nouvellement
transformé, je l’ai appelé le « PLn » pour signifier d’une part la nécessité d’un
dépassement de son état originaire (et encore artistique), et d’autre part la
nécessité d’une fondation idéologique et politique pour un « plan » désormais
devenu « plateforme ». Grâce à cette plateforme, la « liberté », à laquelle
faisait référence la définition d’origine, est poussée à un tel excès qu’elle
entraîne la dissolution de tout « type » possible jusqu’à maintenant connu. Il
faudrait pousser la recherche pour un PLn qui supprimerait tout concept de
type, celui-ci étant devenu le critère enfermant les individus et leur vie dans
des cadres établis (on pourrait affirmer : la typologie est un crime).
EL
:
J’admire la capacité que tu as, en tant qu’historien, à pouvoir « oublier »
d’une certaine manière ce que tu sais pour prendre des positions très fortes.
C’est un mécanisme fondamental dans la création architecturale. L’intuition, le
jeu et le rêve auxquels on doit nécessairement s’abandonner durant certains
moments du processus de conception sont le contraire de l’ignorance. L’idée
d’une rationalité poétique m’a toujours intéressé dans l’architecture. On la
retrouve chez Henri Labrouste, Auguste Perret, Édouard Albert, Pierre de
Montreuil ou Fernand Pouillon, membres officiels du rationalisme constructif,
mais aussi chez Le Corbusier, Brunelleschi ou Schinkel ou Pei, généralement
regardés comme plus formalistes. L’architecture accomplie dans son ensemble est
une poétique de la raison, pour la bonne raison que l’architecture est un art
de l’utilité. L’architecture est sous-tendue par une forme de rationalité, mais
qui n’est pas cartésienne. Cette rationalité cherche à répondre à toutes les
questions en un seul geste, dans une démarche synthétique et inclusive. La
colonne dorique, par exemple, répond autant à la nécessité structurelle de
porter un fronton et une charpente qu’à la nécessité esthétique de fabriquer
une sculpture pour répondre à cette question tectonique. Une colonne dorique
n’est ni un poteau, ni une sculpture au final : elle est les deux à la fois.
L’architecture est toujours dans le dépassement de la question posée par
l’exacerbation volontaire des contraintes données et imaginées : elle met en
œuvre un état ultime de la raison que j’ai qualifié de sur-rationalisme.
Dépasser la question posée, cela consiste à résoudre une équation dans laquelle
certaines données sont quantifiables, comme les budgets, les surfaces, la
construction, la fonction, et d’autres ne le sont pas, comme le contexte, la
beauté, la signification, la poésie. Parler de poésie peut sembler étrange,
mais au fond n’est-ce pas ce que l’on aime dans toute architecture accomplie ?
Cependant tout dépend de l’ordre dans lequel on envisage les choses. La poésie
doit être le résultat, et non le but de départ. Il en va de même de la
subjectivité. Il convient de la repousser au maximum pour que l’architecture
puisse se fonder sur des motivations rationnelles et objectives. Ainsi,
l’architecture peut parler à travers un architecte qui aspire humblement à
n’être que son simple vecteur; les nécessités mettent en vibration l’intelligence
de l’architecte, et ces vibrations sont amplifiées par les principes théoriques
de la discipline architecturale qui permet de les mettre en forme et de les
rendre intelligibles par tous, à l’instar de la corde de la guitare dont la
vibration est rendue audible par la forme du corps de l’instrument et
l’arrangement efficace des bois précieux. Une culture sophistiquée conduira à
une riche intuition, sur la base de laquelle pourra s’élaborer une architecture
accomplie, brutale et subtile, claire et mystérieuse à la fois, en un seul
mouvement, de même que les bois choisis et savamment agencés donneront au son
de la guitare plus de profondeur et de richesse. Une telle démarche conserve un
substrat de subjectivité que l’on ne peut jamais retirer et qui est le bienvenu
car il constitue la part subjective qui nous échappe à nous-mêmes. Un type de
subjectivité qui est bien différent du style personnel, de ce qui conduit à
faire des carrés blancs sur les façades de ses projets parce qu’on s’appelle
Richard Meier, ou des voiles de béton courbes parce qu’on est Christian de
Portzamparc. L’architecture est un art social, qui a une dimension collective
en ce qu’elle doit incarner des valeurs qui dépassent l’individu et
s’inscrivent dans une certaine culture. Quand on est face au Panthéon de Rome,
on est subjugué par le bâtiment, mais on est aussi subjugué par la puissance de
l’Empire romain qu’il incarne. On se dit qu’on est face à une civilisation, à
une organisation sociale, politique et symbolique qui est parvenue à réaliser
un tel édifice, et certainement pas avant tout face à l’architecture d’un
individu. Dans ce sens, on peut dire que la rationalité vise à accomplir le
devenir politique de l’architecture, sa fonction d’art collectif qui est aussi
la condition pour créer des formes à la fois singulières et collectives, aussi
significatives que mystérieuses. Elle est, aujourd’hui plus que jamais,
nécessaire, car elle nous guide pour entamer le parcours conceptuel qui nous
permettra de la maintenir en tant que discipline pratique et culturelle
sophistiquée tout en faisant face à la raréfaction des ressources et des
sources d’énergie.
Emmanuel
Caille : Mais en quoi le rationalisme se distingue-t-il vraiment du
pur fonctionnalisme ? Comment devient-il autre chose que la réponse à un
ensemble de contraintes qui s’incarne dans des formes répétitives, telles que
les trames que l’on voit se multiplier aujourd’hui ?
RG
:
Je voudrais en revenir à la dimension politique de l’architecture du
rationalisme en faisant référence à Antonio Negri. Dans la continuité de
Spinoza, de Marx, de Nietzsche et de Foucault, Negri préfère parler de la
multitude plutôt que du peuple. Il s’adresse à une multiplicité d’individus
plutôt qu’aux masses indistinctes. C’est pour cela que, dans Superstudio, on
s’est proposé d’explorer un dispositif qui puisse permettre aux individus
d’exprimer leur liberté, leurs choix, sans être contraints par des plans
rigides et des types. Le projet du rationalisme ne peut être redéfini, à mon
avis, que sur la base des changements conflictuels qui se produisent dans la
société contemporaine. Sinon, on en revient à une autonomie de l’architecture
qui ne sert qu’à promouvoir l’autobiographie de créateur et donc, dans ce cas,
le rationalisme risque de ne pas sortir de sa dernière phase dénommée, au
milieu des années 1960, « rationalisme exalté » et que l’on a récemment
commencé à envisager comme possible « forme » pour l’architecture
contemporaine. Dans le cadre des nouveaux conflits entre le capital et la
partie de la multitude qui entend résister au profit au nom de l’écologie, du
respect et du partage des ressources, ou de l’intégration sociale (sans plus de
« murs »), il est possible d’entamer une réflexion sur les principes d’un
projet qui possède la force de l’antagonisme dans ses outils opérationnels. Il
est donc nécessaire d’identifier le degré zéro, le fondement, le noyau dur
d’inertie sur lequel fixer les caractéristiques du projet du rationalisme
antagoniste.
EC
:
Comment cette position s’articule-telle avec la tendance à l’archaïsme, que
l’on a vu monter en puissance ces dernières années ?
RG
:
L’architecture a toujours été obsédée par la question des origines. On connaît
le « théorème » de la petite cabane rustique à travers lequel on a cherché à
expliquer la naissance du temple antique pour réaffirmer, dans les moments de
crise de la discipline, le principe d’imitation des structures primitives,
détenteur illusoire d’une vérité pure. L’archaïsme auquel tu fais référence à
des traits semblables ; il possède en lui-même une volonté freudienne
d’identité inatteignable, sinon à travers un traitement artistique de la
matière et de la forme pour arriver à une expressivité originaire et pure –
rien de plus loin, à mon avis, de ce qui doit devenir le centre idéologique du
projet contemporain.
EL
:
Ce qui fait que l’architecture échappe au pur fonctionnalisme est qu’elle
produit des formes. Elle peut se baser sur des paramètres très différents,
comme pour les tenants des big data par exemple, mais au final elle va toujours
s’incarner dans une forme qui va être interprétée par des individus. Jusqu’ici,
les rationalismes ont été monodimensionnels, que ce soit le rationalisme
structurel d’un Viollet-le-Duc, le rationalisme fonctionnaliste des années
1920, ou encore le « rationalisme exalté » d’Aldo Rossi. Il est difficile
d’atteindre une forme d’innocence dans la situation actuelle. Par innocence
j’entends une certaine capacité à trouver des raisons d’agir suffisamment
fortes pour qu’on puisse leur trouver une valeur pour elle-même, intrinsèque.
La condition postmoderne dans laquelle nous nous trouvons est, certes,
extrêmement sophistiquée culturellement, mais on sent aussi que les incessantes
manipulations formelles auxquelles elle se livre tournent un peu à vide sur le
fond. Elle fait que tout se vaut, que tout est égal et légitime, y compris dans
l’architecture. Certains architectes réduisent leurs bâtiments à de cuistres
collages de citations, à l’instar de musiciens ou d’artistes plasticiens, c’est
un phénomène qui entraîne l’ensemble du monde culturel. L’histoire en ce sens
peut être dangereuse car, ce qu’on nomme l’histoire, c’est ce que chaque époque
a produit de plus beau, de plus significatif. Il est très tentant d’utiliser la
beauté inventée par d’autres en la recopiant plus ou moins, tout en laissant
croire, avant tout à soi-même, qu’elle vient de nous. Il faut connaître
profondément l’histoire tout en sachant s’en tenir à distance. Elle tend à être
une substance addictive. C’est à cela que sert la théorie, à établir un filtre
entre les sirènes de l’histoire, dont parlait Roberto, et la pratique. La
théorie est ce par quoi l’histoire peut devenir opératoire dans les projets.
Pour autant, il ne faut pas faire table rase de l’histoire. Des bâtiments
d’architectes comme Zaha Hadid ou Frank Gehry sont certes expressifs, mais ils
représentent surtout l’individualité de leur créateur. Ils visent à sidérer en
se retirant volontairement du champ disciplinaire. La Fondation Louis-Vuitton
dit seulement que Gehry voulait faire un bâtiment comme un nuage : vaine
private joke. À l’inverse, un bâtiment comme le Centre Pompidou est
intelligible. On comprend qu’on a voulu superposer de grands plateaux libres en
rejetant à l’extérieur toute la structure et la tuyauterie. Le projet a la
capacité à être discuté, et ainsi à atteindre une dimension collective, à
rebours des icônes des années 2000 qui visaient seulement à sidérer, à couper
le souffle et la parole, rendant ainsi impossible tout discours, une
architecture de bruit blanc. Le rationalisme, tel que j’essaie pour ma part de
le décrire, est un processus de conception. Il consiste à dire que faire un
projet d’architecture, c’est à la fois définir sa forme, ce qui est le rôle
premier d’un architecte, et en même temps définir un récit théorique qui
justifie la forme, qui lui donne des règles et un sens. Le plan libre que
Roberto explore dans Superstudio renvoie bien sûr à Le Corbusier. Mais ce sont
des ingénieurs et des entrepreneurs comme François Hennebique et Paul Cottancin
qui ont inventé les poteaux et les dalles. Cependant, seul Le Corbusier a su
s’emparer de cette invention pour la transporter dans un champ culturel et
artistique et conceptualiser le plan libre. La rationalité architecturale
consiste à élaborer ce récit conceptuel qui fabrique un cadre pour le projet,
dans lequel des décisions qui pourraient paraître irrationnelles dans un autre
contexte conceptuel deviennent rationnelles, justifiées par une suite de
raisonnements. Dessiner un projet avec des pilotis pourrait paraître absurde en
dehors des zones soumises à l’inondation. Mais dans la pensée de Le Corbusier,
les pilotis deviennent indispensables pour signifier que le bâtiment ne repose
plus que sur des points. Au fond, la rationalité architecturale vise à rendre
rationnels des dispositifs irrationnels. Ce processus génère de la surprise,
indispensable à tout bâtiment, mais qui, elle aussi, vient à la fin plutôt
qu’au début du processus. Il en résulte une catégorie de surprise qui est
l’inverse de ce qu’Auguste Perret appelle un « choc sans durée ». La Fondation
Louis-Vuitton relève de cette surprise préalable et éphémère, tandis que dans
le Centre Pompidou la surprise est le résultat d’une série de décisions. Il
atteint le but de la rationalité : construire des surprises durables. Emmanuel
Caille met notamment en avant le systématisme de la trame. Or ne suffirait-il
pas d’atteindre et d’exprimer le fond d’une pensée, comme tu le suggères,
Roberto, pour être rationaliste, quel que soit le vocabulaire formel ?
RG
:
La trame et la régularité sont les conditions nécessaires pour accueillir la
diversité de la multitude. Un de fondements techniques et idéologiques de
projets menés par les « collectifs » de Superstudio est l’analyse de la trame à
ses origines pour en proposer ses potentialités contemporaines, techniques et
idéologiques. Il ne s’agit plus de se confiner dans l’héritage théorique du
rationalisme français et de sa recherche de la vérité du système de structure
qui s’incarne dans des œuvres comme celle d’Eugène Viollet-le-Duc et Auguste
Choisy. L’ossature Dom-Ino, qui semblerait appartenir à cet héritage, en
réalité nous intéresse car elle incarne l’efficacité du capitalisme
triomphante. Nous la voyons aujourd’hui comme un fragment de l’ossature de la
production industrielle à ses origines, quand elle a rendu possible la
construction de l’usine la plus efficace pour la chaîne de montage, et en même
temps (et c’est exactement ça qui nous intéresse le plus aujourd’hui) elle a
créé les conditions d’un rassemblement des travailleurs qui ont pris
conscience, dans l’espace non subdivisé de l’usine, de leur propre force
antagoniste au capitalisme : la classe ouvrière. L’ossature du PLn, et d’un
rationalisme incomplet qui vise à devenir antagoniste, est donc à la fois dans
le capitalisme et contre lui – un cheval de Troie. Nous croyons avoir identifié
dans la trame de l’ossature, dans sa répétition et dans ses plateformes les
instruments pour pouvoir mettre l’architecture à l’échelle des questions
technologiques et politiques contemporaines. Nous espérons qu’en recomposant
l’espace de l’usine autrement à travers l’ossature et ses plateformes, on
pourrait renforcer le pouvoir antagoniste de la multitude et du rationalisme
lui-même. L’architecture va disparaître en tant que question de forme,
d’expressivité autobiographique, poétique ou de choix des références
historiques – c’est le prix à payer pour atteindre le rationalisme le plus
intense, celui qui vise à être antagoniste.
EL
:
La trame fait en effet un retour marqué dans l’architecture française. On est
passé d’un moment « French Touch », où il était impossible de déployer la
moindre régularité, à la période actuelle où la trame est partout, jusqu’à
presque devenir un style. L’émergence de cette nouvelle architecture doit
beaucoup à Lacaton & Vassal, bien qu’ils bénéficient rarement de la
reconnaissance qu’ils méritent. Leurs projets sont l’expression directe de
potentialités constructives, fonctionnelles et même politiques au sens que
donne Roberto à ce terme. Lacaton & Vassal sont profondément fidèles au
Mouvement moderne, à la fois dans ses formes, dans son ambition sociale et sa
générosité spatiale – car le Mouvement moderne n’a pas fait que détruire
l’environnement et mettre les gens dans des clapiers, comme on l’entend parfois
aujourd’hui ! Lacaton & Vassal réinventent tout cela en produisant des
bâtiments à la beauté âpre, qui se présentent comme d’authentiques formes
architecturales, c’est-à-dire des objets dont l’extériorité manifeste quasi
littéralement les nécessités d’une intériorité – je ne parle pas ici d’espaces
intérieurs et extérieurs, mais de l’ensemble des nécessités, matérielles et
immatérielles, à l’œuvre dans la définition d’une forme, et de la manifestation
finalement matérielle de ces nécessités à travers un projet. Ils ont une influence
profonde dans l’architecture que l’on voit émerger en ce moment, qu’on
l’appelle rationaliste ou non. Mais il reste encore probablement à distinguer
le bon grain de l’ivraie, car il ne suffit pas d’habiller de grilles des bâtiments
conventionnels par ailleurs pour produire des architectures intenses et
pertinentes. L’image de la rationalité n’est pas forcément la rationalité, dont
nous ne devons jamais perdre de vue que son but ultime est de nous permettre de
concevoir des bâtiments à la fois pertinents pour répondre aux besoins de leur
époque et singuliers dans le sens où la rationalité nous permet de pousser
notre imagination dans ses retranchements et de dépasser la subjectivité. Il
faut bien entendu aussi se réjouir de voir cette vitalité nouvelle : depuis
longtemps l’architecture française n’avait pas su susciter un tel intérêt, notamment
au-delà des frontières. Il reste sans doute maintenant aux architectes qui
s’inscrivent dans ce flux à interroger ce qu’il a de commun.
Entretien mené par Emmanuel
Caille, retranscrit et récrit par Paul Bouet

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
CLASSEMENT PAR CHIFFRE D’AFFAIRES DES AGENCES D’ARCHITECTURE FRANÇAISES (AU CA SUPÉRIEUR À 1 …
Chaque année, d’a publie un classement des agences d’architecture par chiffre d’affaires. Celui-ci repose uniquement sur des données financiè… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6
L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6
L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |
 |