Au-delà du Rationalisme (2/2) : Trois remarques sur la situation contemporaine
Rédigé par Dominique LYONPublié le 17/10/2021
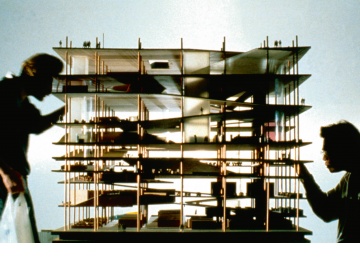 OMA, Jussieu, Two Libraries, Paris, 1992. |
Dossier réalisé par Dominique LYON |
Premièrement, les matériaux
communément utilisés sont moins riches et leurs possibilités d’assemblage sont
limitées par de strictes prescriptions techniques et par la faiblesse des
budgets qui laisse peu de place à l’intelligence constructive. La base
expressive de l’architecte rationaliste en est réduite d’autant. Certains prennent
acte de cette réduction de registre pour transformer leur architecture en leçon
de « réalisme » ou de « frugalité ». Ils courent le risque
que le moindre geste échappant à la stricte économie paraisse superflu et que l’appauvrissement
soit considéré comme un surcroît de vertu. Si le dépouillement prend comme
argument de coller à la réalité nue pour en tirer des raisons imparables, il
trouvera avantageux de réduire le réel à sa plus simple expression, de le
dépouiller de sa complexité.
Deuxièmement, la question se pose de la présence de l’ornement. Traditionnellement, il est un contrepoint qui enrichit le message du rationalisme. Or plus aucune convention ne règle ce vocabulaire autrefois savant, riche et relativement convenu. Savons-nous aujourd’hui concevoir un tel ajout qui approfondisse le sens du bâtiment ? Sommes-nous capables d’ajouter à une architecture un motif, qui enrichisse sa perception et contribue à son attrait ? Trop souvent les inscriptions – formules, titres ou textes – apposées sur les bâtiments sont hors de propos et les images ou les formes adjointes paraissent artificielles et maladroites. Il y a là une perte de savoir-faire dont le rationalisme pâtit.
Ce registre expressif mérite d’être
repensé pour éviter que l’architecture s’en remette à l’abstraction, à une
métaphysique de l’espace qui pose l’architecte en « créateur », en détenteur
de la puissance du vide ; posture qui limite l’intelligibilité de son
bâtiment, à rebours de l’ambition première du rationalisme.
Troisièmement, l’état de notre
société, réputée fragmentée, est devenu insaisissable. On la sonde mais on ne
se risque plus à lui fixer un horizon. Tout mouvement architectural théorise
son rapport à la société et aspire à améliorer ses conditions d’existence. Il
le fait en lui offrant des avantages, du confort par exemple, mais aussi des
représentations qui valorisent l’image qu’elle se fait d’elle-même. La
modernité des années 1950-1960 et le renouveau architectural en Espagne et aux
Pays-Bas dans les années 1990 y ont réussi. Toute architecture témoigne du
souci que nous prenons à notre établissement et contribue ainsi à la
connaissance de nous-même. Néanmoins, il arrive souvent qu’une part active de
la société n’adhère pas à ces préoccupations et que le politique retranscrive
cette résistance dans des règles ou des slogans qui heurtent l’intelligence
architecturale. On comprend alors que certains d’entre eux, par une sorte d’orgueil,
se replient sur une position élevée d’où ils dispensent des exemples de raison
claire et constante correspondant à une société raisonnable.
Mais si ces architectures portent
peu d’attention aux attentes contradictoires qui se manifestent dans l’instabilité
sociale, ne risquent-elles pas de perdre une part essentielle de leur raison d’être ?
Elles suggèrent que notre société fragmentée demande à être réconfortée par la
répétition de formes simples formant repères. Est-ce bien le cas ? Ne revendique-t-elle
pas, au contraire, la remise en cause des représentations dominantes et une
meilleure prise en compte des différences ?
Face à ces contradictions, si
l’on veut faire évoluer l’idée du rationalisme, sans se départir de sa rigueur
intellectuelle, il convient de revisiter ses principes, après en avoir nommé
les limites.
Les limites du système de
justification
En citant des archétypes, en
aspirant à des formes supposées « objectives » et en évoquant la
nécessité constructive, les architectes rationalistes cherchent des raisons
profondes d’avoir raison. Cependant, en trouvant des justifications dans ces notions
surplombantes, ils les entourent d’une « aura » qui tient plus de la
métaphysique que de la rationalité. Car la raison est moins une abstraction qu’un
processus : un exercice toujours renouvelé qui se pratique en élaborant
des arguments sensés et en les articulant suivant une chaîne quasi logique d’arguments.
Elle est stérile quand elle se limite à appliquer des présupposés
disciplinaires, utile quand elle se pose des problèmes. Par exemple, si l’architecte
questionne le rôle des principaux éléments architecturaux (la structure, l’enveloppe,
les circulations, les éléments servants, les fluides, etc.) jusqu’à reconsidérer
leur potentiel, il peut trouver de nouvelles raisons de faire qui relèveront l’intérêt
de l’architecture.
Deux illustrations de ce
processus. D’abord, de manière sans doute trop ironique pour notre sensibilité
actuelle, James Stirling à fait de ce questionnement un jeu savant, plein d’intelligence,
d’humour et de sensualité. Ses bâtiments, notamment la Neue Staatsgalerie de
Stuttgart, articulent des éléments marqués par différents moments de l’histoire
de la discipline (le mur, la colonne, l’ossature, le remplissage, la fenêtre,
la rampe…) et ils les confrontent aux conditions contemporaines afin de créer
des distorsions. L’ensemble montre une grande force plastique, affiche une
belle cohérence intellectuelle, questionne le goût moderne qui valorise l’abstraction
et constitue un récit.
Rem Koolhaas fait preuve quant
à lui d’une raison plus froide quand il interroge le rôle des éléments architecturaux.
Pour son projet de la BNF, les espaces servants (les magasins) ne sont plus des
éléments subordonnés. Ils déterminent le principal de l’architecture et les
parties nobles de la bibliothèque y creusent leur place. Le projet renverse la
hiérarchie courante. Dans sa proposition pour la bibliothèque de Jussieu, le
sol, les circulations verticales et les plafonds forment une surface continue, alors
qu’ils sont généralement organisés en plans distincts. Dans l’ambassade des
Pays-Bas à Berlin, l’escalier principal ne magnifie aucun grand hall d’entrée
comme les conventions l’imposeraient ; il disparaît en tant qu’élément
autonome. Il fuit pour courir à travers la masse bâtie puis il reboucle sur
lui-même et toutes les pièces du programme s’y greffent.
Ces manipulations purement
architecturales sont issues de démarches parfaitement articulées où l’exercice
de la raison vient déranger l’ordre des lieux communs, qui sont l’endroit même
où la raison s’épuise. Sans doute l’avenir du rationalisme passe-t-il par la
remise en cause des notions d’archétype, de nécessité et d’objectivité.
Les limites de l’indifférence
au travail de la forme
Dans notre société hautement
organisée et contrôlée, toute forme architecturale qui réussit à être bâtie
dans l’espace public a le pouvoir d’exprimer, à un moment donné, notre
intelligence collective. Elle livre un état de nos aptitudes. Cette
responsabilité, l’architecte la partage avec son client, son producteur.
Par exemple, le Centre
Pompidou à Paris donne l’impression d’une société ouverte, portée à se
renouveler en s’engageant dans un projet ambitieux. Projet que ses architectes
et les institutions culturelles ont su formuler. Le Centre Pompidou à Metz, qui
partage la même ambition, réussit moins bien à communiquer cette dynamique et
peine à constituer une référence dont on puisse se prévaloir. La ville, ses
habitants peuvent s’estimer frustrés d’un potentiel inexploité.
Les formes architecturales
sont révélatrices elles informent sur notre système. Les connaissances qui
peuvent être tirées de ces productions ne se limitent pas à la compréhension de
problèmes strictement architecturaux. Quand des architectes et des producteurs
font le choix de la rigueur architecturale et de la retenue expressive, quelle
idée de notre société donnent-ils ?
Pour répondre, aidons-nous d’une
comparaison. Considérons l’opération de logements des Hautes-Formes, livrée en
1979 par Christian de Portzamparc et la RIVP. Ses formes variées composent
une sorte de théâtre. Elles veulent offrir, en réduction, l’expérience
inépuisable de la ville dense. L’image que ce bâtiment donne de nous-même, a contrario
de celle, plus uniforme, promue par le mouvement moderne, est celle d’une
société faite de différentes possibilités de vie qui cohabitent et forment un
tout. Ici, pas de trame génératrice qui installe le neutre au motif qu’il rend
tout possible. Il s’agit plutôt, à l’échelle de cette opération, d’augmenter
raisonnablement les possibilités d’expérimenter la condition urbaine. Assumer
des différences, marquer des singularités, c’est, quand il s’agit de loger les
gens, une manière d’accorder de l’importance à l’intimité, en garantissant le
pouvoir d’être soi, plutôt que tout.
Pareillement, Balzac a donné l’image
saisissante de la société de son temps, cette « comédie humaine », en
décrivant les différents types qui la constituaient, en s’attachant aux
différentes formes de vie, aux différentes apparences, en les opposant pour en
restituer la vitalité conflictuelle, sans en idéaliser aucune.
En regard, l’architecture
rationnelle dépouillée donne l’idée d’une société qui se satisfait de formes
simples, communes, relativement neutres. Une société qui ne chercherait pas à
investir dans de nouveaux récits, mais plutôt à vivre librement et également
sans qu’on lui raconte des histoires.
Une société qui voudrait concilier
les différences.
Un modèle vient à l’esprit.
Celui du gratte-ciel new-yorkais que décrit Rem Koolhaas : une enveloppe
indifférente, purement pragmatique, capable d’abriter toute l’énergie de la
ville par l’empilement des programmes les plus divers. Des lieux transformables
aussi afin de sécuriser la rente immobilière. Cette figure architecturale est
produite par une société américaine violente, portée par un capitalisme
survitaminé, dérégulé, où les différences extrêmes se côtoient sans s’effacer, où
une grande liberté d’établissement est permise.
L’architecture rationnelle se
garde de faire référence à ce modèle de société. Plus consensuelle, elle fait
néanmoins une promesse similaire : le pragmatisme pur, qui exige la
neutralité formelle et la réversibilité, offre les conditions bien suffisantes pour
que la vie s’installe sans contrainte, sans rien perdre de sa dynamique.
Reste que, dans notre société très
organisée, remplir de vie l’architecture dépend moins du laisser-faire ou de la
spontanéité sociale que d’une compétence spécialisée, adossée au politique :
l’ingénierie sociale. Cette expertise est nécessaire à l’architecture
rationnelle dépouillée, qui valorise le neutre et l’indéterminé, plus qu’à
aucune autre. Ce d’autant qu’elle est transparente, qu’elle laisse
transparaître « la vie » et que le politique, organisateur du social,
a besoin de visibilité. L’image visée est celle d’une société créative et
pacifiée. Pacifiée parce que sublimant ses différences en diversité. Pacifiée
parce que créative. Pour satisfaire cette image idéale, on va jusqu’à inventer
des programmes où la participation et l’échange sont de rigueur, au risque de
créer une sociabilité artificielle : locaux partagés, potagers
participatifs, maison des projets…
Dépasser la rationalité, c’est
accepter les conflits. C’est reconnaître que les différences réclament des
formes. C’est nommer les tensions, décrire les dissemblances, puis les
constituer en un récit sensé. C’est toute une histoire.
Les limites de la recherche de
raisons communes
Implicitement, l’architecture
rationnelle dépouillée adresse un message politique : ses formes claires sont
conçues pour ne pas gêner la fabrique du social. Elles rendent possible l’appropriation,
l’auto-organisation, et restent ouvertes aux évolutions sociétales du fait de
leur réversibilité. Cette position évoque une société « inclusive », adepte
du consensus, capable de gérer les tensions causées par des ambitions
divergentes et par des différences de culture ou de styles de vie. Une société
qui n’a pas besoin de trop d’autorité supérieure pour s’organiser dans la
durée, qui a appris à réguler ses passions et qui serait donc rationnelle, à l’instar
de l’architecture.
Cette position politique est
illustrée par des images de simples constructions légères évoquant la
spontanéité, cohabitant dans de grands espaces isotropes, transparents,
ponctuées de plantes en pot et de mobilier sans prétention. Une vie légère, un
bonheur communicatif, une grande liberté. Sans doute, si la société n’est pas
arrivée à ce stade d’harmonie, il est dans la nature même du métier d’architecte
d’estimer que ses réalisations peuvent influer heureusement sur les
comportements.
Pour autant, aucun architecte
n’ignore que le corps social remet en cause les manifestations de l’autorité, relativise
les savoirs et reste traversé par des tensions. Il constate que des groupes,
constitués en minorités, exigent d’être reconnus selon leurs spécificités. Cette
tendance vers plus de diversité réclame d’enrichir nos représentations. Elle
concerne donc l’architecte qui doit intégrer ces tensions dans le registre de
ses arguments.
Est-il suffisant de définir l’idée
du commun à partir de la neutralité, au motif qu’elle ne contraindrait personne ?
Ne faut-il au contraire enrichir le vocabulaire des formes architecturales pour
satisfaire la multiplicité des attitudes et des situations ? Quoi qu’il en
soit, l’architecture rationnelle dépouillée adopte une position intéressante :
face à des demandes contradictoires, à la complexité croissante, à l’incertitude,
elle s’en remet à une structure générale, moderne, qui nous est familière, plutôt
qu’à l’attitude postmoderne qui exploite les particularités, au risque de la
confusion.
Le général est préférable au
particulier, c’est l’argument fort du rationalisme. Il se trouve que cette opposition
peut être dépassée dans le cadre même du rationalisme. Il suffit de changer de
posture en cessant de considérer la société à partir de généralités.
La société n’a pas besoin qu’on
la considère en général : elle s’exprime très bien en particulier et ne
manque pas d’interroger directement l’architecte. Pour entendre ce qu’elle
formule, il suffit de considérer attentivement la situation précise dans
laquelle l’architecte est placé à chaque projet. Toute une manière d’être de la
société s’y révèle crûment à travers le programme, les réglementations, l’état
de l’espace public et du patrimoine, le budget, l’attitude des différents
acteurs et leurs ambitions… Le réel se manifeste là, et c’est toujours
différent, toujours particulier ; mais dans le même temps cela forme un
ensemble suffisamment fourni pour constituer l’expression d’une part significative
de la société, du général.
Cette expression est la seule
que l’architecte puisse entendre précisément, la seule dont il peut parler en
connaissance de cause. S’il ne discerne pas ce qui se joue là de conflits, d’absurdités,
de potentiel et de poésie ; s’il n’y voit pas la possibilité intrinsèque d’un
réarrangement, d’une actualisation ; s’il n’y trouve pas les moyens de
satisfaire une demande latente de changement ; s’il ne saisit pas la part
de vitalité propre à la société qui s’y manifeste ; s’il n’en tire pas
directement et exclusivement ses raisons d’agir, alors les raisons qu’il se
donne n’auront rien de général. Elles pourront se référer à des préconceptions,
à un ordre préétabli, à la discipline architecturale par exemple, mais ne
sauraient être fondées en général, vis-à-vis de la société.
Un architecte attentif à sa situation,
à cet état de la société auquel il est confronté, peut nommer ce qui s’y joue
de tensions et d’opportunités. Il acquiert ainsi des connaissances pouvant être
considérées comme suffisamment objectives pour que les raisons d’agir qu’il en
tire soient fondées dans une part de réalité. L’architecture qui procède de
cette intelligence échappe au flou des lieux communs et trouve les moyens de
dépasser les conditions ordinaires qui sont si prégnantes. Elle est proprement
stimulante. Elle est curieuse du général et s’en inspire pour produire une
expérience particulière.
Ce processus fondé sur la
raison (l’observation conduit à la connaissance, qui offre des raisons d’agir) produit
une double critique : celle du rationalisme (il ne se soumet pas à sa
discipline) et celle de l’organisation sociale (il la débarrasse des
faux-semblants pour l’épanouir). Il s’agit alors d’un rationalisme critique.
Ses arguments ne sont pas utilitaristes (le neutre permet tout, la
réversibilité garantit l’avenir, la frugalité est une nécessité…), ils sont par
nature politiques parce qu’ils interprètent ce qu’ils comprennent d’une dynamique
sociale.
Toutefois, le caractère
général des arguments que se donne l’architecte se trouvera confirmé uniquement
si ses raisons peuvent être débattues. Les arguments architecturaux doivent
pouvoir être discutés et évalués par des personnes intéressées, informées des
complexités de la situation, préoccupées par l’intérêt général et
éventuellement dotées d’une responsabilité politique. Pour alimenter le débat,
les raisons de l’architecte ne reposeront sur aucune métaphysique (le beau, l’espace,
l’ordre, l’archétype, la vérité…), sur aucun impératif disciplinaire qui
passerait pour incontestable et elles éviteront de reprendre les éléments de
langage que le politique aime produire et que trop d’architectes s’approprient
trop vite. Si ses arguments, ses mots correspondent aux choses qu’il dessine et
s’ils alimentent les débats d’idées, alors son architecture s’en trouvera
objectivée, elle ne sera pas réductible à la subjectivité de l’architecte.
Les limites du principe de rigueur
Le rationalisme, qui donne l’idée
de la rigueur, repose nécessairement sur une méthode constante, qui par la
répétition en assoit le principe. Les formes qui en résultent ne subissent ni
les caprices de l’actualité ni ceux des affects. Elles s’installent dans un
temps long et valorisent le sentiment de permanence, où résident, idéalement, des
vérités premières. Et comme la simplicité de ses formes l’éloigne de ce qui
pourrait être pris pour de la séduction trompeuse, il passe pour détenir une
part de ces vérités.
Pourtant, on peut avancer,
sans être relativiste, qu’en dehors des sciences exactes – dont l’architecture
ne fait pas partie – il y a plusieurs modes possibles d’exposition de la
vérité. La vérité d’une architecture, ou plutôt son absence de tricherie, ne
doit pas grand-chose à l’idée de permanence. Elle dépend de la justesse de son argumentation
et du rapport exact entre la forme et ces arguments.
L’argumentation est juste si
elle sait intégrer les éléments du réel qui s’imposent à l’architecte. Elle est
rigoureuse si elle donne un sens à ces éléments en les articulant dans une
sorte de récit cohérent. Les formes « vraies » expriment cette
construction intellectuelle et comme elles ne dépendent pas du vocabulaire
resserré du rationalisme, elles peuvent surprendre : en témoignent les
réalisations de Kazuo Shinohara dernière période, et celles d’OMA.
A contrario, la
part de vérité que revendique le rationalisme tient dans ce qu’il ne crée pas
de surprise et repose principalement sur ce qui est considéré comme solidement établi,
remontant d’une fondation. Au point que certaines architectures rationnelles
nous touchent particulièrement quand elles sont établies profondément au sein d’un
état précédant toute forme de récit articulé, dans une sorte d’innocence ou de
non-engagement. Elles appartiennent au registre des « formes fortes »
qui sont ancrées dans notre normalité, dans notre quotidien, et composent la
matière de nos souvenirs communs. Des formes issues d’un monde fortement
organisé : celui du travail, de l’industrie, de la ville urbanisée. Des
formes pragmatiques, qui composent une réalité nue, dont la présence impressionne
sans jamais renvoyer à la dimension individuelle mais se réfère à une force
supérieure à la fois pesante et désirée, à un destin commun, au sein duquel se
reposer.
L’attirance que ces formes
exercent aujourd’hui auprès des architectes est paradoxalement liée au
potentiel que conserve dans nos esprits la part vive de fantaisie que nous
savons être en nous et que nous préférons contraindre. Leur attrait viendrait
autant de leur présence simple et incontestable que de la discipline que nous
nous imposons de ne pas exprimer notre singularité alors même qu’elle nous
remue toujours. D’où le recours au concept psychanalytique « d’inquiétante
étrangeté » que certains (Diener & Diener, Peter Märkli, Éric
Lapierre) utilisent pour qualifier ces formes « archétypiques » quand
ils leur font subir une légère déformation, une subtile aberration, une
déviation mesurée dont ils attendent un effet de coup de tonnerre dans le cours
de la normalité consentie.
La rigueur serait ce qui
subsiste quand on coupe ce qui pourrait surgir depuis notre for intérieur. Reste
à savoir si à la rigueur de l’expression correspond la rigueur intellectuelle.
Pour l’esprit rigoureux, rien ne va de soi, tout est problématique et l’architecture,
mise sous tension, fait bouger les lignes.
Les limites du plan libéré
Le plan libre est une promesse
paradoxale. Celle de vivre libre sans la contrainte du plan. Pour s’alléger, le
plan libre se marque d’une trame légère de points porteurs et se débarrasse des
murs, des clôtures, afin que les occupants se confrontent moins à des formes qu’à
eux-mêmes, sans pour autant s’attacher à des lieux qui sont conçus pour être
réversibles.
Ces plans, rendus dynamiques
par un jeu de lignes fines, prennent une belle qualité graphique. Des biais, des
courbes tendues produisent des tensions dans la régularité de la trame et préfigurent
des zones d’intensité, des secteurs de condensation sociale : des zones
plutôt que des formes. En contrepartie, ce sont les occupants, par les figures
qu’ils composent, qui constituent le corps de l’architecture en donnant de la
chair au plan. Le concepteur adopte ici une attitude bienveillante, son pouvoir
s’exerce à distance, sous une forme neutre pour ne pas gêner cette animation.
Ces dispositions peuvent
correspondre à notre époque, qui est à la recherche de nouvelles formules
démocratiques : consultations citoyennes, participation, référendum, etc. Ce
plan libre est-il libératoire ? Rompt-il les cadres qui nous
brident ? À ces questions de très belles réponses ont été apportées.
Le plan libre de Le Corbusier est
une scène vidée, un plateau nu qui rend possible la construction de machines
architecturales spectaculaires. La libération par le théâtre des émotions. Le
plan libre de Mies est un lieu cérémoniel qui vise au sublime. La libération
par l’élévation. Le plan libre de Cedric Price préfigure les grandes machines
de l’industrie des loisirs et de la culture. La libération par la communion
festive. Le plan libre de Superstudio est une abstraction. Des personnages
oisifs qui ne participent à aucun système le parcourent. Ils passent, et leur
assemblée se limite au noyau familial, à la cellule primitive. La libération
par le retour à un en deçà de la culture. Le plan libre de Constant, trop
imposant, indispose l’irascible Debord qui lui préfère la dérive dans les mille
replis de la ville historique, continuum d’expériences encore ouvert aux marges.
La libération par l’esprit de révolte et par l’alcool. Le plan libre de l’architecture
rationnelle dépouillée ne vise aucun au-delà, ne célèbre aucun désordre, ne
témoigne d’aucun excès. Il est avant tout pragmatique, réaliste : à la
neutralité il associe la liberté d’établissement et le désencombrement de l’esprit.
C’est une opération troublante.
N’est-ce pas des lieux communs
dont il faut se libérer ? N’est-ce pas la diversité des expériences
architecturales qui stimule l’esprit ?
Comment un projet, éclairé par
la raison, peut-il aboutir à une formule générale face à la multiplicité des
circonstances dont il est entouré, alors que c’est bien l’humain qui est le
moteur des circonstances ? La vocation humaniste de l’architecture ne
consiste-t-elle pas à mettre l’humain, le sensible, leurs variations, au centre
du projet, plutôt que la raison constructive ?
Comme si notre intelligence
architecturale ne nous portait pas, avant toute autre considération, à résister
à l’uniformisation du monde, aux formes vides que le système économique produit
en toute puissance et dont s’accommode trop souvent le politique. Toute-puissance
du vide. Nécessité d’y opposer des récits et des formes.
Pour illustrer un lien
possible entre plan libre et diversité des formes, considérons le plan de la
banque d’Angleterre à Londres, conçu par John Soanes entre 1791 et 1833. La richesse
de ses dispositions offre une palette d’expériences architecturales et,
pourtant, c’est l’idée d’un tout qui s’impose. L’impression qui prévaut est
celle d’un bâtiment qui ne s’épuise pas. Son plan continu composé de formes
multiples rejoint l’idée première des plans tramés : « tout est
possible ». Mais ici la liberté est liée à la variation, à la stimulation
des sens. Elle n’est pas une abstraction, c’est une métaphore de la vie.
On peut objecter que ces
formes particulières sont encombrantes quand le plan libre promet d’être
réversible à souhait. Tout bâtiment est transformable, la plupart ont été transformés.
Mais, que gagne-t-on à la transformation ? Le neutre, le générique se
transforme en même ; le gain est économique.
Transformer un bâtiment marqué
par des formes « dépassées » n’offre-t-il pas aux fonctions qui les
investissent la possibilité de sortir des normes ? Ce que l’on gagne, ce
sont des expériences nouvelles, qui dépassent l’ordinaire.
Dépasser le rationalisme
Avant de se manifester dans un
objet architectural, le rationalisme est un discours. Les raisons qu’il se
donne relèvent d’une construction intellectuelle, d’une narration, qui emprunte
à la rhétorique afin de raconter sa part de vérité : ici, il s’agit de
convaincre de la possibilité de réguler notre environnement et les passions qui
s’y rattachent, à partir des principes généraux qui viennent d’être évoqués. Trouvant
en elle-même ses propres justifications, cette proposition rappelle le discours
militant qui entretient un rapport engagé avec la réalité et comme détaché de
ses éléments contradicteurs. Ce strict récit est affaibli par ce biais, comme
il l’est du fait qu’il ne saurait s’appuyer fermement sur des vérités tangibles,
ou des nécessités premières (les domaines de la construction et de la
durabilité sont évolutifs et restent fortement dépendants des circonstances).
La première qualité du
rationalisme consiste à faire correspondre discours articulé et formes
architecturales. On apprécie et l’on apprend du rationalisme quand on réalise
que l’architecture gagne à procéder d’une narration, d’une stratégie narrative.
Dépasser le rationalisme oblige à changer l’élaboration de son discours.
Pourquoi vouloir dépasser le
rationalisme ?
Pour ouvrir le registre des
arguments fondant les formes, en toute rigueur. On fait évoluer le rationalisme
si, en conservant sa rigueur déductive, on intègre dans la narration des faits
et des circonstances pris, non pas dans le corpus limité qui constituerait le
dedans de l’architecture, mais autour de l’architecture, au sein de la
situation où elle baigne, précisément, et à laquelle il faut bien attribuer le
nom de réalité. Pas la réalité en général, mais celle qui se manifeste au plus
près de l’architecte et dont il s’agit de produire une représentation cohérente,
qui fasse tenir les faits ensemble, dans une sorte de destin commun que l’on
imagine stimulant.
Le mode narratif donne un sens
aux modalités du réel, qui paraissent triviales, fluctuantes et contradictoires.
Il les articule dans une suite raisonnée, construit des enchaînements, établit
un ordre, une logique, et produit des raisons qui gagnent en objectivité dès
lors qu’elles sont tirées des situations réelles.
La qualité d’une architecture
vient de l’intelligence du récit qu’elle porte et des récits qu’elle inspire.
Les architectures muettes sont sans qualité, leur platitude ou leur vanité
déprime l’esprit : on préfère ne pas en parler et ce silence nuit à l’architecture.
L’architecture dépend du
langage : de ce que l’on raconte de ce que l’on sait de ce qui nous entoure
et nous presse. Le langage est l’outil créatif le plus souple et le mieux
adapté pour établir les raisons d’être de l’architecture en conformité avec
notre situation, avec notre état dans le monde. Il ouvre un registre infini aux
dispositions architecturales.
Faire dépendre l’architecture
de l’ordre du discours, de l’expression verbale logiquement construite,
garantit contre les approximations et les lieux communs, évite le recours à la
métaphysique et rend inopérante la redondance propre aux convictions
militantes. L’échange des idées architecturales est ainsi rendu possible ;
le débat peut s’engager, qui sert la promotion de la culture architecturale et
affermit l’autorité de l’architecte face à ceux qui la contestent ou l’ignorent.
Cette dynamique intellectuelle
rigoureuse constitue un rationalisme critique, car c’est bien de la réalité
dont elle fait le récit, et si elle ne critique pas la réalité, elle trouvera
peu à dire.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :
| Vous n'êtes pas identifié. | |||
 |
SE CONNECTER |  |
S'INSCRIRE |
> Questions pro |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 4/6
L’apparente exhaustivité des rendus et leur inadaptation à la spécificité de chaque opération des programmes de concours nuit bien souvent à l… |
 |
|
Quel avenir pour les concours d’architecture ? 3/6
L’exigence de rendus copieux et d’équipes pléthoriques pousse-t-elle au crime ? Les architectes répondent. |
 |














